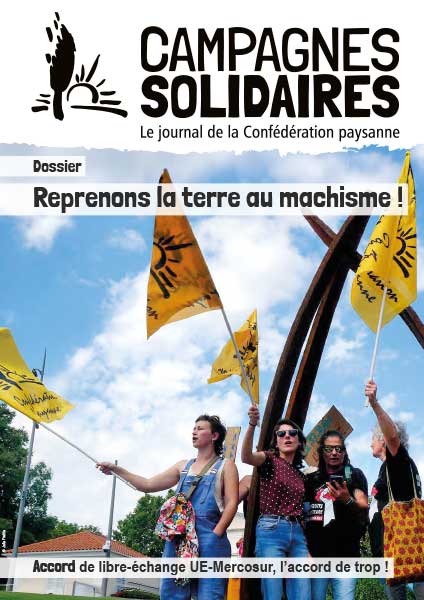Les sectionaux, une forme originale de propriété foncière collective
 27.12.2021 -
27.12.2021 - La France profonde gronde, la rumeur enfle et la peur court plus vite que Carlos Ghosn devant la justice... Les fumées de la colère noircissent l'horizon, les vitres volent en éclat, les villes sont en alerte, les nantis serrent les fesses et les députés huilent les sièges du parlement de leur transpiration qui pue la peur…
Gilets Jaunes ? Réforme de la PAC* ? Non, juillet 1789, la Grande Peur.
Inquiets à l'idée qu'une répression nobiliaire pourrait suivre la prise de la Bastille, les paysans prennent les devants et brûlent châteaux et livres de droits seigneuriaux.
Par une chaude nuit d'août, les députés de l'Assemblée Constituante, constitués de la Noblesse, du Clergé et du Tiers-Etat (la bourgeoisie), tentent de calmer le jeu. Une fois l'option de la répression exclue, ils surenchérissent tour à tour dans un élan égalitariste teinté du souci de chaque caste de ne pas laisser les autres s'en sortir mieux : c'est ainsi que seront abolis à la fois les privilèges ecclésiastiques, féodaux, des provinces, des villes et des corporations. Inspirant.
L'une des conséquences méconnues de cet épisode est la création des fameux sectionaux.
A cette époque, les communes n'existent pas encore - elles seront créées en 1790 - et la population est majoritairement rurale. Les privilèges abolis, les habitants des hameaux s'approprient collectivement les terres et bâtiments qu'ils utilisent déjà en commun : forêts, sources, champs, moulins, fours à pain… C'est la naissance des biens de section, une forme de propriété privée collective basée sur l'usage, véritable épine dans le pied de la propriété privée exclusive qui, elle, est réservée aux plus nantis. Les biens de section sont généralement des terres assez pauvres, mais qui permettent aux plus démunis de partager un parcours pour les bêtes, du bois de chauffage, l'accès à l'eau, etc.
Aujourd'hui, cette forme originale de propriété existe encore, surtout dans les zones de montagnes et particulièrement dans le Massif Central (la Lozère à elle seule compte près de 75 000 ha de sectionaux). Autrefois charnière dans l'organisation sociale et économique des campagnes, elle est menacée de disparition depuis 2019, avec un projet de loi visant purement et simplement à dissoudre les biens de section.
Comment en est-on arrivé là ? Le sujet est extrêmement complexe et toute tentative de le résumer en quelques phrases est un exercice périlleux, mais l'enjeu en vaut la chandelle : aujourd'hui, les sectionaux représentent une réelle alternative à de nombreux maux de notre société actuelle et méritent d'être défendus comme tels. Comme tout modèle alternatif, il demande des ajustements, de la réflexion et de l'énergie, et a subi de nombreuses attaques et détricotages depuis plusieurs décennies.
Concrètement, un bien de section est une parcelle de terre dont la jouissance est partagée entre ses habitants. Vous avez bien lu : la seule condition pour devenir « ayant droit » (terme supprimé, nous y reviendrons) d'un sectional, c'est d'y habiter. Pas besoin d'être propriétaire ni héritier d'une longue généalogie locale : si vous y habitez, alors vous êtes membre de la section, ce qui vous donne des droits d'usage : sur les sections forestières, cela inclut par exemple le droit d'affouage, c'est à dire l'accès au bois de chauffage, au bois d'œuvre, ou encore aux revenus de la coupe de bois, ainsi que le droit de cueillette des champignons et autres ou encore le droit de chasse.
A travers ces différents usages, on comprend mieux que les biens de section étaient réellement destinés à la subsistance des populations. Sur les parcelles agricoles et pastorales, les usages sont variés : troupeaux communs menés en parcours ou location de la terre sous forme de bail ou de convention à un paysan membre de la section.
Ça, bien sûr, c'est la théorie. A l'époque, cela forçait les gens à décider collectivement de la gestion des terres dont ils étaient ayant-droit, ce qui limitait les comportements prédateurs individuels.
Avec la déprise agricole, les biens de sections se sont petit à petit vidés de leurs usagers, et les habitants des hameaux ont progressivement perdu le contrôle de leur gestion.
Amorcé dès 1850, l'exode rural a vu son impact sur les sectionaux renforcé par la montée en puissance des services forestiers, qui viennent concurrencer les usages agricoles et pastoraux des biens de section en y plantant des forêts « productives ».
Les sectionaux se retrouvent ainsi soumis au code forestier de 1827 à 1985, puis ils passent sous la tutelle du code des collectivités territoriales avec la loi Montagne.
Là où les commissions syndicales, constituées d'électeurs de la commune, géraient la section – ses usages, ses revenus et leur redistribution – viennent se substituer les conseils municipaux. Les commissions syndicales existent toujours à certains endroits, mais leur constitution est devenue plus difficile depuis 2013. Pour créer une commission syndicale, la nouvelle loi impose en effet à la section de compter au moins 20 électeurs sur la commune et de disposer d'un revenu cadastral de 2 000 € - une obscure disposition fiscale rarement mise à jour qui est censée déterminer la valeur fiscale de la terre, et sert ici clairement à rendre la constitution de commissions syndicales très ardue.
La section est devenue une personne morale, dépourvue de toute indépendance financière, sous tutelle des communes et donc de l'État. Sur la demande des conseils municipaux, le préfet peut aller jusqu'à autoriser la vente d'une section à un particulier, le transfert de celle-ci à la commune elle-même, ou le changement d'usage de la section - même si la commission syndicale s'y oppose - au nom de l'intérêt général.
La taxe foncière qui était autrefois réclamée aux membres de section est désormais payée par le conseil municipal. Désinvestis de leurs devoirs, les ayants-droit deviennent de simples membres de section qui en oublient leurs droits.
Parmi les paysans qui sont restés, certains ont cherché à mettre la main sur ces terres pour agrandir leur surface de production et donc leur richesse individuelle, dans un contexte économique toujours plus concurrentiel et une société toujours plus privée de ses liens de solidarité traditionnels. Certaines sections ont ainsi été vendues à des particuliers, membres de la section ou venus de communes voisines. Même lorsque les sections ont été maintenues en l'état, c'est à dire en propriété privée collective, il est courant que certaines vieilles familles considèrent qu'elles ont un droit exclusif sur ces terres travaillées de génération en génération, ce qui peut poser des difficultés lorsqu'un nouvel agriculteur qui s'installe dans le hameau répond à toutes les conditions pour demander à son tour de louer le bien de section.
En effet, sur les zones agricoles de la section, la loi prévoit une priorité donnée aux agriculteurs qui résident sur la section au moment de la répartition des terres, qui disposent du siège et d'un bâtiment d'exploitation et qui exploitent des biens sur le territoire de la section.
Dans un pourcentage non négligeable des cas, les sections représentent une condition vitale au maintien de certaines exploitations. Le bail est généralement renouvelable mais peut être cassé à tout moment par le conseil municipal. Ces loyers constituent pour partie les revenus de la section.
Dans l'état actuel du régime des statuts agricoles, profondément orienté vers l'individualisation et la transformation des paysans en chefs d'entreprise, les sections ne peuvent donc pas garantir une installation pérenne, puisqu'elles mettent en concurrence les différents agriculteurs ayants-droit sur la section.
Ce qui différencie la propriété privée collective de la section des terres communales, c'est justement cette priorité. Elle est à la fois un atout et un handicap. En effet, sur une terre communale, il n'y a pas besoin de résider sur la commune pour prétendre à un bail. Selon les cas, les biens de section contribuent donc à protéger leurs terres des spéculations foncières débridées et de l'accaparement foncier aveugle de fermes-usines. Cependant, le fait de devoir être déjà installé pour prétendre à un bail sur un sectional est un frein à l'installation de nouveaux paysans. Si cette modalité venait à être modifiée, cela représenterait un formidable levier d'installation pour de nouveaux paysans, ce qui est l'une des revendications majeures de l'AFASC.
Les sections représentaient à l'époque pour leurs membres une véritable source de revenus : la vente du bois de chauffage ou la location des terres agricoles était redistribuée aux membres de la section, qui, rappelons-le, étaient à l'origine majoritairement eux-mêmes des paysans ou des artisans avec des revenus très faibles. Les revenus ainsi dégagés permettaient de s'acquitter de la taxe foncière de la section ainsi que de son entretien.
Depuis 2012 pour les parcelles forestières et depuis 2013 pour les parcelles agricoles, ces revenus ne peuvent être distribués qu'exclusivement en nature et non en fiducier, et sont souvent accaparés par les communes qui les intègrent au budget communal.
Le fait que les revenus des sections ne puissent pas être redistribués sous forme d'argent à ses membres et ne peuvent légalement que servir l'intérêt de la section est un vrai problème : certaines sections, qui ont par exemple passé des conventions avec ERDF pour installer des lignes haute tension, de l'éolien ou du photovoltaïque, se retrouvent avec des sommes qu'elles ne peuvent guère dépenser. Une section, bien qu'elle soit une personne morale depuis 2011, ne peut en effet pas acheter de foncier pour agrandir son patrimoine puisqu'elle n'a pas d'autonomie financière. La création de nouveaux sectionaux est d'ailleurs interdite – on se demande bien pourquoi.
Par un habile jeu de « pas vu pas pris », les communes flèchent donc ces revenus qui ne leur appartiennent pas vers des dépenses communales dans l'indifférence des services de l'État. Sous couvert d'autonomie financière des communes, confrontées à la baisse drastique de leurs subventions et vouées à jouer le jeu de la rentabilisation, ce sont donc des revenus privés collectifs qui sont le plus souvent détournés sans concertation, donnant lieu dans certaines communes à un drôle de mélange des genres.
En l'absence généralisée de commissions syndicales du fait des dispositions de la loi de 2013 , les décisions quant au devenir de la forêt sectionale ou des parcelles agricoles, qui devraient être prises en concertation avec ses usagers et habitants, se font ainsi en conseil municipal sans publicité particulière, quant elles ne sont pas carrément déléguées à des intermédiaires type ONF* ou SAFER.
Les parcelles forestières étant soumises au régime forestier, l'ONF*, organisme public également soumis de plus en plus à un environnement concurrentiel et une logique de rentabilité, assiste les conseils municipaux gestionnaires, moyennant honoraires et faisant fi des obligations de consultation des électeurs pour l'établissement du plan de gestion et le programme des coupes.
De même, la SAFER peut devenir par délégation la gestionnaire des baux ruraux qui se concluent sur les sectionaux, prélevant sa dîme au passage. Tout comme l'ONF*, la SAFER, société privée d'intérêt public, est sommée de s'auto-financer.
Concrètement, chacun prend tout ce qu'il peut là où il le peut.
Bureaucratisation et complexification du droit des usages ont ainsi peu à peu subtilisé, en silence, la capacité d'un collectif d'usagers à déterminer le devenir de la terre qu'ils habitent.
On l'a dit, le modèle n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister et de proposer un cadre à la propriété collective, cadre qu'il nous appartient de faire évoluer. Son éventuelle disparition prochaine s'inscrit parfaitement dans la logique néo-libérale d'individualisation, de privatisation et de marchandisation à tout va. Une gestion collective du foncier, avec tous les défis qu'elle implique, est sans doute complexe, mais elle est surtout vivante, mobile, protéiforme, évolutive et formidablement créative et innovante.
Pour aller plus loin, explorez le site extrêmement complet de l'AFASC
Vous pouvez aussi signer la pétition pour refuser le projet de loi visant à la disparition des sectionaux.
En téléchargement :
Guide de préservation des terres agricoles
Site de l'AFASC, sectionaux